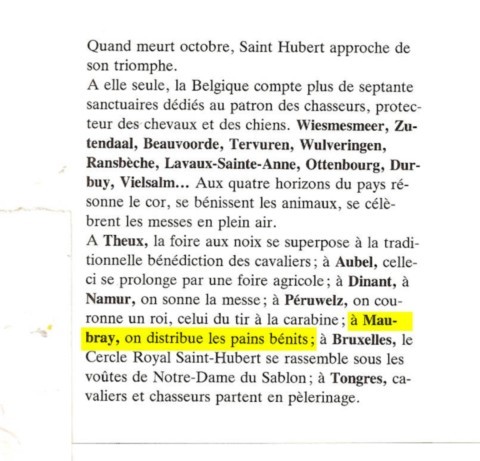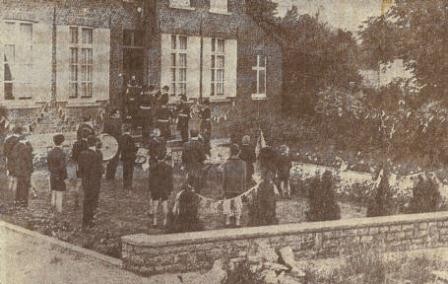La Fête de Saint-Hubert
Avant-propos
Son épouse Annie (✞) disait de lui sans ironie qu’il incarne la « mémoire du village » ; en fait, il ne semble pas que son assertion puisse souffrir le moindre doute. Effectivement, après avoir effectué deux reportages circonstanciés à caractère historique (tous deux présents sur ce site), l’un sur les fanfares, l’autre sur les sociétés théâtrales, OMER HELLIN nous fait revivre les événements qui ont marqué la fête de Saint-Hubert depuis son origine, et ce grâce à une abondante documentation, soigneusement conservée.
Omer a, en effet, répondu très rapidement (il a d'ailleurs été le seul) à mes questions sur les origines de cette fête à Maubray. Voici donc son compte rendu agrémenté de photos d'archives et diaporamas.
Excellente lecture !
Serge ROMMES.
A. GENESE
I. L'initiateur.
1. C’est à ROBERT LEROUX, de nationalité française, copropriétaire avec son frère ALAIN de l’entreprise CHICOREE LEROUX, à Orchies (FR), que revient l’initiative de la mise sur pied d’une fête de Saint-Hubert à Maubray, en 1961 pour la première fois; pas de quoi s’en étonner puisque l’industriel du Nord de la France était passionné de chasse.
2. Alors que, par respect pour la coutume, ce genre de célébration aurait dû se dérouler à une date proche de la fête patronale, fixée par le calendrier au 3 novembre, l’époque choisie (fin juin-début juillet) par son initiateur fut plutôt anachronique. Il n’empêche qu’elle resta figée à travers le temps puisque, depuis l’origine, aucune dérogation n’eut lieu. La période pré-estivale fut en effet estimée plus propice à assurer un succès populaire à la manifestation ou, à tout le moins, à prendre une solide option sur sa réussite. La participation régulièrement nombreuse du public corrobora la rectitude du jugement ; hormis les Maubraisiens, un grand nombre de personnes étrangères à la commune – dont pas mal de Français au cours des premières années – ont toujours contribué à faire de cette commémoration un franc succès.
3. Ainsi, depuis 1961, sans discontinuer, Maubray honore annuellement avec faste, à cheval sur juin-juillet, le saint patron des chasseurs.
II. Les motivations de l’initiateur.
Quelles pouvaient être les motivations de ROBERT LEROUX ?
- Par priorité : certes son amour pour la chasse ; par ricochet, peut-être une ouverture à caractère tant social que mondain.
- Mais pourquoi à Maubray ? : il faut savoir que ROBERT LEROUX est venu s’installer à Maubray dans l’immédiat après-guerre dans une propriété appartenant au Prince de Ligne, d’Antoing, et située à l’orée du bois de Lanchon. Il en fit sa seconde résidence, qu’il dénomma MA GUEOLE.
Graduellement, il s’investit dans la vie associative du village. Son objectif non dissimulé était de réconcilier les deux clans qui s’affrontaient et divisaient la population depuis plusieurs décennies suite à des querelles familiales, à savoir :- d’une part, les tenants de la FANFARE ROYALE, et de son cercle dramatique ARS & CARITAS,
- et d’autre part, les membres et sympathisants de la FANFARE L’UNION, et de sa troupe théâtrale LA RENAISSANCE.
En fait, malgré sa notoriété, ROBERT LEROUX échoua dans cette tentative, certes louable ; c’était, à n’en pas douter, faire fi un peu trop vite de toutes les dissensions du passé, par ailleurs encore bien vivaces à l’époque.
Son investissement dans le mouvement associatif s’opéra par le biais d’un engagement ( sponsorisation ?) dans des activités à caractère sportif : balle pelote (très en vogue), cyclisme. Dans la foulée, il fut à l’origine de la création d’un SYNDICAT D’INITIATIVE, qui rassembla des personnes issues des deux tendances artistiques locales avec, en soutien, le curé de la paroisse LEON DEPAUW.
III. Organisation des fêtes de Saint-Hubert.
1. C’est ce SYNDICAT D’INITIATIVE qui, au départ, prit en charge l’organisation des célébrations, les chevilles ouvrières en étant MAURICE BRABANT (secrétaire) et PAUL DELLETTRE Junior (trésorier), sous la présidence de ROBERT LEROUX.
2. Une constance caractérise l'ordonnancement et le déroulement des offices religieux en l’honneur de Saint-Hubert depuis les origines jusqu’à nos jours, à savoir :
a. une abondante décoration florale agencée autour d’un tapis de fleurs dans la nef centrale de l’église, elle-même toujours très arborée.
3. Une équipe de bénévoles, évolutive dans sa composition dans le temps, s’acquitte toujours avec enthousiasme et détermination des tâches relevant de l’intendance.
4. La reconnaissance médiatique ne tarda pas à se matérialiser puisqu’en 1981 déjà, G. RENOY/H. LA BARTHE citaient nommément Maubray dans leur ouvrage intitulé « Le grand livre de la fête : folklore en Belgique », ainsi qu’on peut s’en rendre compte ci-après :
extrait du "Grand Livre de la Fête"
5. Trois « patrons » ont assuré la pérennité des célébrations de Saint-Hubert depuis 1961 : ROBERT LEROUX, CHARLES DELEHAYE et JEAN-MARY VIVIER. Passons maintenant en revue les réalisations significatives qui, sous leurs impulsions respectives, ont contribué à asseoir cette pérennité.
Les fantaisies d’une météo turbulente ont été à l’origine de la décision en 1967 de reporter l’office à l’intérieur de l’église, une pratique qui se perpétua.
En ce qui concerne le niveau de participation des fidèles, les comptes rendus de presse font état de plusieurs centaines de personnes chaque fois, et même d’un millier en 1968.
2. Sonneurs de trompe : Une fête de Saint-Hubert se conçoit difficilement sans la présence de sonneurs de trompe ; ainsi, plusieurs sociétés, chacune d’elles à différentes reprises, sont venues sonner l’hallali :
- le rallye gayant, de Douai,
- le rallye trompes des Flandres,
- le rallye-Hainaut,
- les cors de chasse de Ligne.
Des haut-parleurs, habilement dissimulés dans le clocher, diffusaient les sonneries de trompe.
3. Chorales : Au début des années 70, en lieu et place des cors de chasse, dans un souci de diversification, il fut fait appel pendant plusieurs années consécutives à la Chorale Mixte des Mineurs d’Auberchicourt, une des meilleures chorales de France, comptant 55 exécutants, et qui venait de remporter le premier prix au concours international de Sélestat, auquel participaient 32 sociétés.
A la fin des années 70 et dans la décennie suivante, la chorale Saint-Amand, de Maubray, dirigée d’abord par Basile Verdonck puis par son frère Robert, rehaussa de sa présence la cérémonie liturgique.
4. Fanfares : Les phalanges musicales du village prêtaient également leur concours à la fête :
- la FANFARE ROYALE (dirigée par Léonce VIVIER) jusqu’en 1963, c-à-d pratiquement jusqu’à sa dissolution,
- la Clique de la jeune paume, forte d’une quinzaine de musiciens sous la baguette d’Edmond ROBERTE ; elle était aussi présente lors d’importantes luttes de jeu de balle pelote ; elle se produisit jusqu’en 1968, date à laquelle elle s’éteignit,
1964 constitua en quelque sorte une apothéose, puisque Mgr DESCAMPS, qui s’était fait excusé l’année précédente, présida la cérémonie et prononça l’homélie : ce fut donc un grand honneur de recevoir le recteur magnifique de l’Université de Louvain (encore unifiée à l’époque).
Au cours de la deuxième moitié des années 80, la décoration traditionnelle de l’église s’enrichit d’un tableau d’assez grande dimension consacré à Saint-Hubert peint par Maurice BRABANT ; depuis lors, il demeure en permanence attaché aux cimaises de l'église.
11. Agapes : En tant que bon organisateur, ROBERT LEROUX se devait de retenir à déjeuner ses invités de marque, ce qu’il fit complaisamment dans sa résidence MA GUEOLE en clôture de chaque cérémonie annuelle !
II. Sous l’égide de CHARLES DELEHAYE (1990-1996).
1. C’est une autre personnalité française qui prit la relève en 1990 : le docteur CHARLES DELEHAYE, président du conseil d’administration de la polyclinique de La Louvière, à Lille. Son grand mérite est d’avoir « démocratisé » la fête de Saint-Hubert, en ce sens que – toutes choses étant égales par ailleurs – il convia chaque fois les chasseurs, traqueurs, fermiers, propriétaires terriens octroyant le droit de passage aux chasseurs, petits éleveurs, bénévoles et nombre d’amis à un drink à l’issue de la messe. Tout ce petit monde se retrouvait dans la cour de la maison qu’il avait acquise, à quelques pas de l’église, dans la Rue de la gare et qu’il désignait sous le vocable de « pavillon de chasse » ou parfois de « petite Louvière ».
4. Après l'apéritif, chasseurs et traqueurs se retrouvaient à l'intérieur du pavillon afin de partager le lunch, tandis que certains invités se regroupaient pour prolonger les réjouissances dans des restaurants des environs.
5. En 1994, au cours du drink, un hommage fut rendu à Jacques DEREUX, le fidèle garde-chasse : MM LEROUX et DELEHAYE lui remirent conjointement la médaille d’or du ROYAL SAINT-HUBERT CLUB DE BELGIQUE. Sur la photo, apparaissent, de gauche à droite, Robert LEROUX, Jacques DEREUX et Charles DELEHAYE.
6. Pendant toute cette période présidée par CHARLES DELEHAYE, les Petits Eleveurs du Tournaisis continuèrent à présenter au Salon Jurion leur exposition florale et avicole, qu’ils étendirent même au matériel de jardinage.
III. Sous l’égide de JEAN-MARY VIVIER (1996-2015 )
1. Le passage de témoin entre CHARLES DELEHAYE et JEAN-MARY VIVIER eut lieu en 1996. Cette année-là, c’est ensemble qu’ils présidèrent la célébration ; ils y associèrent même les responsables du TRAP-CLUB (société de tir aux clays) de Maubray. Comme antérieurement, la Fanfare de Vaulx s’occupa de la partie musicale. Pour la dernière fois eut lieu l’exposition avicole au Salon Jurion.
2. En 1997, JEAN-MARY VIVIER – directeur général de L’OREAL BELGILUX – devint le seul maître à bord. Sur la photo : Jean-Mary et son épouse.
- d’une part, la présence des cors de chasse du Rallye de Ligne,
- d’autre part, le concours de l’Orchestre des cadets de l’Harmonie Royale La Concorde, de Péronnes, dont JEAN-MARY occupe la présidence. Durant quelques années, la chorale CHANTELAC, de Péronnes, prêta aussi son concours.
OMER HELLIN
juillet 2009
ndlr : modifié en :
mai & juillet 2011,juillet 2012, juin 2014 & décembre 2024)